Nous sommes tous des grands pingouins
Texte de la conférence donnée à Bordeaux le 13 septembre 2019 à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Sepanso (en partenariat avec l’Association Internationale Jacques Ellul)

1.
La veille de sa mort, Cabu illustrait ma chronique hebdomadaire dans le Canard, dont le titre était : « Attention, extinction ! »
Je citais Raphaël Billé, un chercheur écolo, qui écrivait : « Je suis assez convaincu que l’homme pourrait encore prospérer dans un monde avec beaucoup moins de biodiversité qu’aujourd’hui, des récifs coralliens moribonds, des forêts tropicales réduites à peau de chagrin, une agriculture faisant massivement appel aux intrants chimiques et à la pollinisation mécanique, et par-dessus le marché un réchauffement de 4 ou 6°C, des centaines de milliers voire des millions de victimes de maladies respiratoires et d’événements climatiques extrêmes chaque année… » (1) Ce n’était pas un constat cynique, mais un cri d’alarme, celui d’un scientifique obsédé par la sixième extinction. Après avoir brossé le tableau très documenté du désastre en cours, il disait ne pas vouloir « sombrer dans un catastrophisme mécaniste qui suppose que tout est joué d’avance ». Mais il notait que la fameuse Convention sur la biodiversité signée à Rio en 1992, qui affirmait la possibilité de « rendre compatible la protection de l’environnement et le développement économique et social », n’avait été qu’un « vœu pieux ». Il notait aussi que les deux protocoles de Carthagène (2000) et de Nagoya (2010) sur la protection de la biodiversité n’avaient pas servi à grand-chose. Il s’interrogeait.
Puisque les cris d’alarme des scientifiques et les grand-messes internationales ne suffisent pas, que faire ? Comment convaincre les politiques ? Il racontait cette anecdote sur Roosevelt. Celui-ci venait de recevoir les défenseurs des droits civiques qui lui demandaient des changements urgents. Roosevelt leur dit : « Vous m’avez convaincu, je suis d’accord avec vous ». Puis il ajouta : « Maintenant descendez dans la rue et obligez-moi à le faire ». Je concluais mon article ainsi : « Pour éviter ce monde invivable dont ils entrevoient l’avènement, ces chercheurs espèrent un miracle. »

Avec Cabu, nous avions discuté, cherché une idée de dessin. Il avait représenté Hollande face à une girafe, un lion et un panda enfermés dans une cage. Hollande leur promettait de stopper la disparition des espèces menacées s’ils votaient pour lui. Comme souvent, à la lecture de mon papier (2), il s’était gratté la tête, et comme souvent, il m’avait dit, en exagérant son air perplexe : « On va avoir du mal à s’en sortir ! » Et il avait ri. Il riait, car il pensait qu’il faut toujours rire du pire. Que la vie prendrait toujours le dessus. Il écoutait chaque jour Charles Trenet pour s’en convaincre : la vie, la joie, doivent toujours prendre le dessus.

2.
Je n’ai pas de portable, pas de voiture. J’ai pris l’avion une fois ces dix dernières années. Je ne suis jamais allé aux Etats-Unis, et n’y irai jamais. Le Grand Canyon me fait rêver, comme tout le monde, mais je ne m’y rendrai pas. Je n’irai pas voir « les 100 lieux qu’il faut avoir vus avant de mourir », les 100 musées, les 100 villes, les 100 îles paradisiaques...
J’essaie de connaitre le jardin, la rivière, la forêt, la colline d’à-côté. De les regarder. Pourquoi aller à l’autre bout du monde si l’on n’a jamais regardé un arbre ? Vraiment regardé ? Si on ne connait rien de la beauté qui est encore ici, sous nos yeux ? Si on ne cherche pas à la protéger ?

Pourquoi protéger les espèces ? Parce qu’elles peuvent nous être utiles ? Parce qu’on pourrait trouver des médicaments à partir d’un insecte vivant au fin fond de la forêt tropicale ? A cause des grands principes qui nous enjoignent le respect de la Nature avec un grand N ? Au nom de la science qui nous demande de préserver la richesse de la biodiversité ? Parce que la vie est peut-être une merveilleuse exception, que dans tout l’univers elle pourrait n’être apparue que sur notre seule planète ?
Oui, bien sûr. Mais aussi, et peut-être surtout : au nom de la Beauté. La nature est belle, le vivant est beau, mystérieusement beau. Nous vivons au cœur de ce mystère. C’est lui qu’il faut préserver.
Mais il faut la protéger aussi au nom de l’étrangeté. Je préfère le mot « étrangeté » à celui d’« altérité », qui est un peu tarte à la crème. Il met l’accent sur ce fait tout simple : il suffit de regarder plus de 30 secondes n’importe quel animal, une mouche, un chat, un lézard, un toucan, un anchois, un scarabée, pour être saisi. Saisi d’admiration, une admiration mêlée d’un peu d’effroi, saisi par l’étrangeté de cette forme vivante. Toute rencontre avec un animal (et même avec un végétal, n’oublions pas que la sixième extinction touche aussi de plein fouet le monde végétal) est une rencontre avec l’autre. Avec une autre façon de vivre, d’habiter cette Terre. Et cette sensation nous fait toucher du doigt notre statut d’humain. Nous sommes très différents de cette vie animale, mais nous lui appartenons pleinement.
3.
Avant que se fasse le consensus sur le réchauffement climatique, on a vu s’agiter nombre de climato-sceptiques. En France, le plus connu était Claude Allègre. Une récente étude a montré qu’entre 2000 et 2016, les médias ont largement favorisé les climato-sceptiques : ils leur ont offert 49% de place en plus qu’aux partisans du réchauffement. Le même phénomène va-t-il se dérouler aujourd’hui à propos de la sixième extinction ? On voit apparaitre en ce moment une nouvelle espèce –c’est rare ! Une espèce qu’on pourrait appeler les extincto-sceptiques. Rien que cette année, trois livres d’extincto-sceptiques ont été publiés. Passons-les en revue brièvement.
« Contre l’écologisme » (3), de Bruno Durieux. Il a été ministre de la Santé puis du commerce extérieur sous Mitterrand. Il est aujourd’hui maire de Grignan. Ses arguments : pourquoi s’inquiéter de la disparition des abeilles, puisque « la production mondiale de miel a plus que doublé en cinquante ans » ? Il trouve ridicule et hors de prix la protection des animaux : « N’a-t-on pas investi récemment un million d’euros pour ménager deux écoducs de 39 mètres pour le passage de hérissons sous une autoroute ? » Un vrai scandale. Le fond de sa pensée, c’est : la planète en a vu d’autres. « Qui soutiendrait que la planète d’aujourd’hui souffre de l’extinction des plésiosaures, des ammonites ou du mastodonte d’Amérique ? Qui soutiendrait que la nature et l’homme contemporain se porteraient mieux si l’on ressuscitait les dinosaures, les mammouths ou le grand pingouin ? »
Là, j’ai vécu ça comme une attaque personnelle.
Les écosystèmes sont résistants, la preuve, dit-il : Tchernobyl ! On voit régulièrement émerger cet argument, l’argument de la renaissance de la biodiversité autour de Tchernobyl. Rien de plus énervant. La zone interdite autour de Tchernobyl fait 1000 km2. Des chercheurs américains ont constaté, en déposant ici et là des carcasses de poissons morts, et en installant à côté des caméras à infra-rouge, que nombreux et très divers étaient les animaux qui venaient s’en nourrir. Ils en ont conclu que la vie foisonne autour de l’ancienne centrale. Et alors ? Evidemment ! Ca fait 33 ans qu’à de rares exceptions près l’homme n’entre plus dans cette zone. Pas de chasseurs, aucune activité humaine, la nature livrée à elle seule : forcément, les animaux prolifèrent. Leur ennemi numéro 1 a disparu. Mais qui dit qu’ils sont en bonne santé pour autant ? On peut vivre dans une zone irradiée et se reproduire, et être prolifique. Est-ce le signe que tout est revenu à la normale ? Non. C’est une vie malade. C’est une vie malade qui prolifère. Qu’un ancien ministre de la Santé puisse écrire que la renaissance de la biodiversité autour de Tchernobyl confirme « la résilience de la biodiversité », c’est quand même formidable.
Durieux conclut son chapitre ainsi : « La préservation des écosystèmes nécessite des moyens matériels et financiers que seule la prospérité économique apporte. » D’où il déduit que : « la croissance est une condition nécessaire à la vie des écosystèmes, comme à la résolution de la plupart des grandes questions environnementales ». Il ne fait que répéter ici l’argument dominant : pour protéger la nature, il faut de l’argent. Donc, il faut de la croissance. C’est elle qui a détruit la nature et qui continue à la détruire ? Pas grave : on va s’auto-persuader qu’elle va maintenant faire le contraire de ce qu’elle a toujours fait. La croissance va servir à protéger la nature. On n’est pas loin du « 1984 » de George Orwell, ce monde où les mots ne veulent plus rien dire. « La guerre c’est la paix », « la liberté c’est l’esclavage », « l’ignorance c’est la force ». Maintenant : « La croissance, c’est la protection du vivant ». On remarquera que tous les responsables du monde politico-économique partagent cette même conviction. Malgré toutes les mises en garde, ils continuent de croire à la croissance. Rappelons que celle-ci est le résultat de la course au profit maximum, lequel repose sur la mise en coupe réglée du monde –et donc du vivant.
Autre livre, celui de la géographe Sylvie Brunel, qui s’intitule : « Toutes ces idées qui nous gâchent la vie » (4). Elle y va au canon. On prétend défendre les gentils animaux ? Mais les requins tuent les touristes. Les loups égorgent les brebis. Ceux qui veulent « se réconcilier avec la nature, la bonne blague » sont des « esprits malades », qu’anime « la haine de l’humanité ». Ces gens-là veulent « mettre sous cloche » des territoires (mettre sous cloche, on retrouve souvent cette expression : un territoire qui n’a pas la chance d’avoir été bétonné est un territoire « mis sous cloche »). Et d’ailleurs, c’est quoi, cette biodiversité qui serait menacée ? C’est juste une liste. La liste rouge de l’UICN, l’Union mondiale de la nature. En 1964, elle comptait environ 90 000 espèces. Aujourd’hui elle en compte 7000 de plus. Alors que dans l’intervalle, la population mondiale a doublé. Ca ne va donc pas si mal que ça ! Allez voir la liste des espèces disparues : « elle est relativement courte ». Et la plupart des disparitions se sont produites au XIX° et au début du XX°. D’ailleurs on a pu sauver « un grand nombre d’espèces ». La conférence de Nagoya promet que la superficie des terres protégées passera à 17% d’ici 2020, c’est quand même pas mal ! Citation : « Bien sûr que certains écosystèmes sont dégradés, mais la bonne nouvelle, c’est que rien n’est irréversible : on sait aujourd’hui restaurer des forêts, dépolluer des fleuves, recréer dans les îles de la végétation prétendument endémique ». A l’en croire, restaurer l’Amazonie, ça va être une partie de plaisir.
Son autre grand argument : la nature n’a rien de bienveillant. Notre géographe raconte longuement la tuberculose, la variole, Ebola, la peste. Elle affirme que suite au livre de Rachel Carson paru en 1962, « Printemps silencieux », le DDT a été interdit sous prétexte qu’il tuait les oiseaux. Et que depuis, les moustiques porteurs du paludisme ont fait 50 millions de morts. « Qui paiera pour les 50 millions de morts ? Qui les pleurera ? » Stéphane Foucart, du Monde, a montré en quoi cet argument a été fabriqué de toutes pièces au cours des années 90 dans les cercles des néoconservateurs américains sous l’impulsion d’industriels emmenés par Philip Morris pour discréditer les écologistes. Si le DDT a été interdit aux USA en 1972, il ne l’a pas été en Afrique, ni ailleurs. L’OMS l’a encouragé jusqu’au début des années 80 avant de s’inquiéter de ses effets et de conseiller d’autres moyens de prévention. Mais on ressort toujours cette vieille histoire pour accuser les amis des moustiques d’être des assassins. Sylvie Brunel écrit aussi cette phrase à propos des espèces invasives, auxquels les naturalistes font la chasse, comme les ibis sacrés en Bretagne : « Trop de « gardiens de la nature », au nom d’une vision sélective de la sacro-sainte biodiversité, se comportent en véritables nazis, autant à l’égard des espèces qu’ils jugent indésirables, que des hommes qui ont le malheur de se trouver sur le territoire de leurs protégés ». Le mot « nazi » n’arrive pas ici par hasard. Hitler aimait les animaux : voilà un des refrains habituels des anti-écolos, voir Luc Ferry (5). Elle aussi parle de la « nature luxuriante » de Tchernobyl. Sur l’Amazonie, elle a ces mots : « Cessons de pousser des cris d’orfraie et d’insulter les Brésiliens quand ils défrichent, comme nous l’avons fait en Europe pendant des millénaires ». Bref, le niveau zéro.
Le troisième livre a été écrit par vrai scientifique, un biométricien, Alain Pavé. Son titre « Comprendre la biodiversité », son sous-titre : « vrais problèmes et idées fausses » (6). Pavé ne nie pas vraiment l’effondrement, mais il en minimise l’ampleur et les implications. Il affiche une foi absolue en la capacité de régénération de la biodiversité. Le message général est clair : la biodiversité en a vu d’autres, elle s’en remettra, d’ailleurs l’anthropisation des milieux peut lui être favorable. C’est un livre plutôt confus, où l’on trouve entre autres l’idée que pour les écolos, défendre la biodiversité n’est qu’un prétexte pour lutter contre l’ordre établi. Là encore, vieille rengaine. On dirait du Pascal Bruckner ou du Luc Ferry. Signalons qu’Alain Pavé est membre de la Fondation « Ecologie d’avenir » créée en 2011. Par qui ? Claude Allègre !

4.
Que savons-nous de la 6° extinction ? Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais faire un bref rappel. Le premier à alerter sur cet effondrement du vivant, et à populariser le terme « biodiversité », est le biologiste Edward Osborne Wilson, dans un article publié en 1985. De nombreux autres chercheurs ont suivi, comme Robert Barbault en France. Le premier livre portant le titre « La 6° extinction » (7) est paru en 1997 sous la plume du paléoanthropologue kényan Richard Leakey.
Voilà plus de 20 ans, donc. Le deuxième livre (8) portant ce titre est paru en 2014 sous la plume de la journaliste Elizabeth Kolbert et a reçu le prix Pulitzer.
En juin dernier, 150 experts de 52 pays ont signé un rapport sur l’extinction, sous l’égide de l’IPBES, cette agence de l’ONU qui est à la biodiversité ce que le GIEC est au réchauffement climatique. Leur chiffre-phare : sur les 8 millions d’espèces estimées, un million est menacé d’extinction avant la fin du siècle. Et la moitié d’entre elles peuvent déjà être considérées comme des « espèces mortes ambulantes », c’est-à-dire que si leurs habitats ne sont pas restaurés d’urgence, leur fin est proche. Les trois quarts des écosystèmes terrestres sont « gravement altérés ». Et aussi la moitié des écosystèmes d’eau douce. Et 40% des écosystèmes marins. Faut-il continuer ?

Chaque jour 50 000 hectares de forêt tropicale humide sont anéantis, chaque jour les déserts s’agrandissent de 20 000 hectares supplémentaires, chaque jour, rien qu’en France, 165 hectares de terre sont artificialisés. 41% des amphibiens sont menacés, 33 % des coraux, 27% des crustacés, 25% des mammifères. Certains chercheurs parlent de la possibilité d’une « annihilation biologique » d’ici le milieu du siècle. On le sait, 6° extinction, cela veut dire que jamais la Terre n’a connu une catastrophe pareille depuis 65 millions d’années, depuis la disparition des dinosaures. L’homme est capable de choses formidables ! Rappelons que nous sommes désormais une force géologique, capable de bouleverser la Terre avec autant de puissance qu’un astéroïde, ce que cherche à signifier l’expression « anthropocène », on ferait d’ailleurs mieux de dire « technocène ».
Bref, tout cela peut se résumer en une phrase d’Edward Osborne Wilson : si on ne fait rien, un quart des espèces auront disparu dans un demi-siècle, la moitié dans un siècle (9).

Bien sûr, dans tout cela il y a des marges d’erreur, bien sûr l’art de la prévision n’est pas une science exacte, bien sûr le chiffre de 1 million d’espèces menacées a été choisi pour marquer les esprits, ce sera peut-être 857 345 ou un million 328 497. Mais les données sont là. Même s’il n’est pas uniquement dû au dérèglement climatique, cet effondrement lui est lié. Tout le monde a vu ces photos d’ours polaire perdu sur un bout de banquise cerné par les eaux. Tout le monde sait que les premiers à souffrir du réchauffement sont les animaux. L’acidification des océans, le recul des glaciers, les événements extrêmes, inondations, sécheresse, vagues de chaleur, tempêtes, incendies, tout cela altère les habitats naturels, les récifs coralliens, les forêts, la toundra, les déserts, les prairies, les zones humides, et provoque la disparition de nombreuses espèces. Il n’y a pas que le panda géant et l’ours polaire, mais aussi l’orang-outan de Sumatra, l’éléphant d’Afrique, la baleine bleue, la tortue verte, etc. A court terme, le réchauffement menace un cinquième des espèces qui sont sur la liste rouge de l’UICN. Sans compter les espèces végétales.
Mais il n’y a pas que la science pour nous convaincre que la sixième extinction n’est pas une vue de l’esprit. Il n’y a pas non plus que les innombrables reportages de journalistes qui nous racontent l’effondrement des colonies d’abeilles dans les ruches françaises, les feux de forêt à Bornéo et en Amazonie, l’assassinat des activistes écologistes dans le monde (pas moins de 207 en 2017), la disparition des insectes (voir le dernier livre de Stéphane Foucart (10)).
Il y a aussi notre expérience sensible. Nous, nos yeux, notre mémoire.
Nous sommes nombreux ici à connaitre la fameuse expérience du pare-brise : quand on traversait la France dans les années 70, le pare-brise était couvert d’insectes écrasés. Aujourd’hui, rien. Mais il y a aussi l’expérience du papillon : quand j’étais enfant, dans mon jardin de vacances, je voyais des Vanesse vulcain par dizaines sur les arbustes et les bouleaux. Aujourd’hui, quand j’en vois deux ou trois, je saute de joie. Je pêchais des tritons dans le petit ruisseau qui coulait à l’orée de la forêt. Il n’y en a plus un seul. Le soir, on entendait un concert de croassements qui venait d’une grande mare à quelques dizaines de mètres. Aujourd’hui, c’est le silence. Le silence, pas vraiment : on entend beaucoup plus de voitures.
Ces expériences sensibles nous le rappellent douloureusement : c’est de notre vivant que ça s’est passé. C’est de notre vivant, en 30 ans, entre 1970 et l’an 2000, que les populations d’animaux sur terre, dans les mers et les rivières ont chuté de 40%.
5.
Même si on a pu reprocher beaucoup de choses à Nicolas Hulot, le gel douche Ushuaïa, la fondation Hulot sponsorisée par Rhône Poulenc, et coetera, difficile de ne pas remarquer que ce qui fait sa force, et sa popularité, c’est que chacun perçoit chez lui une vraie sincérité. D’où vient-elle ? De cette expérience sensible, justement : à force de parcourir le monde, il a fini par constater avec effroi que les lieux vierges qu’il visitait dix ans auparavant étaient bitumés, que les plages où les tortues venaient pondre étaient désertes, que le vivant disparaissait à une vitesse effarante. C’est à partir de ce moment qu’il a commencé à ouvrir grand les yeux, à chercher à comprendre ce qui se passait, et à sonner le tocsin.
Que peuvent les extincto-sceptiques face à une conviction née de l’expérience sensible, et corroborée par la science ? Rien. Je ne leur prédis pas un grand avenir. Ils ne feront pas autant de dégâts que Claude Allègre.

6.
Depuis plus de vingt ans, je tiens au Canard une chronique qui parle d’écologie, de mondialisation, de critique de la technique. Depuis vingt ans, j’écris là-dessus, j’effectue une sorte de veille, j’essaie d’informer, d’alerter. Un beau jour, je suis tombé sur l’histoire du dernier grand pingouin. Pourquoi ai-je été frappé par les circonstances de sa disparition ? Pourquoi est-on troublé par une image mentale, une image qu’on forme en soi ?
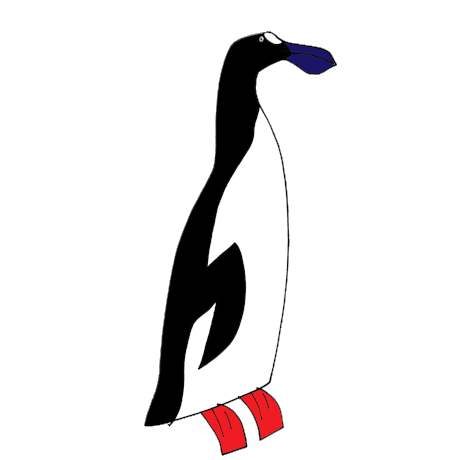
A l’aube du 3 juin 1844, quinze marins-pêcheurs islandais accostent sur l’île d’Eldey. Ils ont ramé toute la nuit. Sur ce minuscule ilôt volcanique et inhabité au large des côtes islandaises, ils espèrent trouver des grands pingouins. Pour les tuer, puis vendre leurs dépouilles à prix d’or. Ils voient deux. Ils leur courent après. Ils les étranglent. Ils abandonnent sur place l’unique œuf qui était près d’eux, et qui dans la poursuite s’est fendu. Ils rentrent au port. Ils vendent les deux cadavres. Et depuis ce jour-là jamais personne n’a plus revu un grand pingouin sur terre. C’était comme une scène de théâtre, simple et tragique.
Mais du moins cette histoire tragique était-elle leur histoire. Et j’ai pensé à toutes les espèces qui aujourd’hui disparaissent, sans que l’homme les ait jamais rencontrées, espèces au fin fond des abysses ou des forêts tropicales, sans que l’homme leur ait donné un nom, dont jamais il ne pourra raconter l’histoire. On a répertorié 1,7 million d’espèces, on pense qu’il en existe cinq fois plus, mais il en est des milliers, des dizaines de milliers, qu’on ne connaitra jamais, car notre mode de vie, nos pollutions, nos nuisances, notre réchauffement climatique, les déciment à grande vitesse.
Nous nous comportons comme des Talibans. Non seulement nous détruisons ce qui se trouve dans les vitrines du musée, mais aussi ce qui se trouve dans les réserves, et qui n’a encore jamais été répertorié. Vous le savez sans doute, la moitié de la Terre est recouverte d’au moins 3000 mètres d’eau. Or, à 927 mètres de profondeur, la lumière ne passe plus. La moitié de la Terre vit dans une nuit éternelle. On a longtemps cru qu’il n’y avait pas de vie dans ces profondeurs. On sait depuis peu qu’elles abritent une vie foisonnante, très variée, avec des formes inouïes, vous avez sans doute tous vu les photos des créatures qui vivent dans les abysses. Cette vie si étrangère à la nôtre, qui ne soupçonne même pas notre existence, nous avons déjà commencé à la détruire, à l’envahir avec nos déchets plastiques, à la tuer avec les canicules sous-marines et l’exploitation des nodules polymétalliques. Nous détruisons à l’aveugle, avec indifférence et placidité, sans plaisir particulier, sans le faire exprès, par une sorte d’inconscience totale. Mais nous détruisons, comme les Talibans, au nom d’une certitude : tout cela ne vaut rien. Toute cette vie animale, cette incroyable inventivité du vivant, n’a aucune importance à nos yeux.
Il m’a fallu cette image, l’image des deux derniers grands pingouins massacrés par l’homme, pour que je me mette à me poser vraiment cette question : comment je fais avec ça ? Avec toutes ces données, ces informations, ces mauvaises nouvelles ? Celles que je lis, celles que je passe mon temps à transmettre aux lecteurs ? Comment vivre dans un monde où se déroule pareil saccage ? Je pourrai m’en tirer par le doute, mais c’est impossible, toutes ces infos sont solidement étayées, recoupées. Je pourrai m’en tirer par le déni, mais je ne m’appelle pas Claude Allègre. Comment garder les yeux ouverts, et ne pas vaciller, ne pas désespérer ? Avoir une vie, des enfants, des jours heureux ? Ces questions, je me les suis posées au début de l’écriture de ce livre, « Lettre au dernier grand pingouin » (11) et elles m’ont occupé pendant près de sept ans. Et ce n’est pas fini… Ce qui m’est interdit désormais, ce qui est interdit à quiconque prend vraiment ces nouvelles au sérieux, c’est l’insouciance. On nous a volé l’insouciance.
7.
Comment le monde réagit il face à cette extinction de masse ? Je vais tenter ici de peindre à grands traits le panorama tel que je le vois. Dans l’ordre, nous verrons comment réagissent les institutions mondiales, puis le monde de l’entreprise, puis le gouvernement français, puis « les gens ».
Les institutions mondiales. Date du premier grand accord mondial visant à freiner l’extinction des espèces : 1992. Il est adopté lors du sommet de la Terre de Rio. Il a pour nom « Convention de la biodiversité biologique animale et végétale ». Il n’est assorti d’aucune contrainte. Son efficacité est parfaitement nulle. Dix ans plus tard, en 2002, ces mêmes pays, au nombre de 189, se fixent une date limite : 2010, décrétée, tout le monde l’a oublié, « année internationale de la biodiversité ». Ils promettent d’assurer pour 2010 une forte réduction du rythme de perte de biodiversité. La France s’engage même à « stopper la perte de biodiversité ». En 2010, les pays signataires le reconnaissent : non seulement le rythme ne s’est pas ralenti, mais il s’est accéléré. Alors ils se fixent, lors de la conférence dite de Nagoya, une autre date limite, 2020. Avec 20 objectifs, les objectifs d’Aïchi. Quand on en épluche la liste, on constate qu’aucun ou presque ne sera tenu. Les deux seuls résultats vraiment concrets de Nagoya, ce sont, un, un modus vivendi entre pays du Nord et du Sud, empêchant ceux du Nord de piller les ressources génétiques de ceux du Sud - du moins sans contrepartie sonnante et trébuchante. Deuxième résultat : le lancement de l’IPBES sur le modèle du GIEC. Créé en 2012, cet IPBES a tenu son dernier sommet à Paris, à l’issue duquel vous vous en souvenez, il lancé ce cri d’alarme sur le million d’espèces menacées à terme d’extinction. Voilà : la communauté internationale en est encore, et toujours, aux cris d’alarme. Il parait que c’est l’an prochain, lors du sommet de l’IPBES qui se tiendra à Pékin, que seront enfin prises de vraies décisions sur la biodiversité… Faut-il y croire ?
Si ces grand-messes cafouillent depuis 20 ans, c’est évidemment parce qu’il existe un conflit énorme entre le Sud et le Nord. Un conflit d’intérêt. La biodiversité, c’est le bois, les poissons, la viande, le tourisme, les ressources génétiques. Le Sud est pauvre, mais c’est lui qui dispose de la biodiversité la plus riche. Il veut conserver sur elle sa souveraineté, afin de mieux pouvoir l’exploiter. Le Nord est riche, et voudrait que la biodiversité du Sud soit déclarée bien commun de l’humanité, de manière à pouvoir la piller tranquillement.
Je caricature, mais à peine. Bien sûr qu’il existe une prise de conscience mondiale, que les études scientifiques sont de plus en plus affinées, élaborées, que la pression sur les politiques est de plus en plus forte. Mais il y a surtout, entre les grandes déclarations, les grandes promesses, et ce qui est réellement mis en œuvre, un gouffre.

8.
Passons au monde de l’entreprise. Après avoir longtemps douté, longtemps pris les écolos pour des rigolos, il a fini par réagir. Pourquoi ? Parce que les assureurs, les banques, les fonds d’investissement, les fonds de pension se sont rendu compte que la crise climatique mettait en danger leur activité. Le réchauffement menace les ports avec la montée des eaux qui risque de détruire les infrastructures, menace les stockages d’hydrocarbures et les pipelines du fait des hautes températures, menace les réseaux de transport d’électricité avec les tempêtes et les fortes précipitations, menace les télécommunications et les centres de données toujours à cause des hautes températures, menace l’agroalimentaire avec la baisse des rendements agricoles, la difficulté d’accès à l’eau, les conflits d’usage pour les terres arables, menace le tourisme avec la disparition des plages et de l’enneigement, etc. Bref, le réchauffement menace sérieusement le business, comme le montre très bien Valéry Laramée de Tanenberg (12). Or, les 2/3 de la hausse du gaz carbonique et du méthane sont imputables à seulement 90 (très) gros producteurs mondiaux de pétrole et de charbon.

En 2015, lors d’un dîner très chic avec
des assureurs et réassureurs, le gouverneur de la Banque d’Angleterre a rappelé à l’assistance que si les estimations du GIEC sont exactes, une grande partie des réserves de pétrole, de gaz
et de charbon ne devront jamais être utilisées. Le tiers des réserves de pétrole, la moitié de celles de gaz naturel et 80% de celles de charbon devront rester enfouies dans le sol. Pour sauver
leur business, et la valeur de leurs actions, qui pourraient se déprécier (des calculs ont été faits, ce serait l’équivalent de 8 fois la crise des subprimes), toutes les compagnies pétrolières
sont en train de désinvestir les énergies fossiles et d’investir dans les « énergies décarbonées », l’éolien et le solaire, notamment. En France, Total vise les 20% de son chiffre
d’affaires dans ce domaine en 2035, Engie fait de même. Les constructeurs automobiles se lancent dans la voiture électrique. Les compagnies d’aviation cherchent à mettre au point des
bio-kérosènes. Le fret maritime, qui prévoit de doubler d’ici 2050, cherche à mettre au point des navires neutres en carbone.
Les grands investisseurs se débarrassent de leurs actifs liés aux énergies fossiles, puisque la demande de brut pourrait chuter d’un quart d’ici 2040. La finance s’agite énormément ; la crise climatique fait peser des risques sur leurs avoirs. Arrêter une centrale à charbon prévue pour durer 40 ans, c’est un terrible manque à gagner. La direction générale du Trésor a chiffré à 600 milliards d’euros l’exposition des banques françaises au risque climatique. Bref, si le business du monde entier s’est mis à la croissance dite verte, ce n’est pas par conviction, ou par altruisme, ou pour se faire louer par l’opinion publique, mais pour se protéger des risques, pour perpétuer son existence, et pour profiter des opportunités. Car chacun sait que les périodes de guerre -et c’est une sorte de guerre qui est en cours-, sont très propices aux affaires, à condition d’être plus malin que le voisin.
Et la biodiversité, dans tout ça ? Le prix Nobel d’économie 2018 William Nordhaus, donc celui qui donne le la, qui exprime la doxa, la pensée dominante aujourd’hui, a exposé dans un livre, « le casino climatique » (13) sa manière de voir les choses. Protéger des espèces menacées coûte cher. On ne pourra pas toutes les sauver. Il propose donc de sélectionner celles qui ont une valeur, et d’abandonner les autres. Logique, non ? Mais comment faire ce tri ? Il note avec sagacité que « les espèces ou écosystèmes rares ne portent pas d’étiquette de prix qui indiquent la valeur. » Il faut donc essayer de leur en attribuer une. C’est immoral ? Non, dit-il : empêcher la disparition des espèces coûte cher, « il y a donc un arbitrage incontournable entre les coûts de nos réductions d’émissions et les risques de disparitions ». « La véritable immoralité, dit-il, consisterait à ne pas tenir compte de la valeur des espèces lorsque nous faisons le compte des pertes dues au changement climatique ». Mais comment leur attribuer une valeur ? Est-ce parce qu’une bonne partie des médicaments occidentaux provient d’ingrédients issus de la forêt tropicale qu’il faut protéger les forêts tropicales ? Nordhaus raconte qu’il a passé tout un été à étudier la question, pour finir par conclure qu’il est impossible d’évaluer le potentiel des richesses médicinales d’une forêt.
Il s’est alors tourné vers une autre option : demander aux gens ce qu’ils sont prêts à payer. Quand dans l’Etat de Washington, il a été question de construire des barrages et d’évaluer leur impact sur les poissons migrateurs, des chercheurs ont calculé qu’en moyenne, les ménages de Washington étaient prêts à payer 736 dollars par an pour préserver les poissons migrateurs. Ce qui nous donne une indication, conclut Nordhaus. Mais, dit-il, tout va se compliquer quand il faudra évaluer ce que les gens sont prêts à payer pour toutes les autres espèces en voie de disparition, des plus proches aux plus éloignées, du parc national de Yellowstone aux glaciers himalayens en passant par les renards et les ours polaires. Il y en a des centaines de milliers !
Du coup, Nordhaus introduit une autre idée : toutes les espèces ne sont pas d’égale importance. Le dodo, qui n’a pas de parents génétiquement proches, est plus important qu’une des 3000 espèces de moustiques qui se ressemblent tous. Il faut classer les espèces selon leur diversité génétique. Et là, il cite des biologistes américains qui après avoir travaillé sur les extinctions passées ont fait cette estimation : environ 80% de l’information codée dans ce qu’ils appellent « l’arbre de la vie » survivrait même si 95% des espèces étaient perdues. Cela laisse entrevoir l’ampleur du massacre qu’une certaine « science » est prête à accepter. Juste une remarque : comme nous, les humains, avons 98% de gènes communs avec les grands singes, si on suit cette logique comptable, on pourrait rayer l’humanité de la carte et garder les grands singes, finalement la perte ne serait pas énorme. Notre prix Nobel de l’économie conclut ainsi : « La biologie moderne va devoir mettre au point de meilleurs indicateurs de l’importance des espèces et des écosystèmes afin d’orienter nos décisions en matière de préservation dans le contexte du changement climatique mondial ». Bref : donner une valeur au vivant, c’est ardu, c’est difficile, c’est impossible, mais c’est pourtant ce qu’on va faire.

Le monde de l’entreprise est-il réellement en train de devenir « vert » ? Le capitalisme va-t-il devenir un « capitalisme vert » ? Beaucoup aimeraient y croire, évidemment. On aimerait pouvoir se réjouir que le système industriel revienne à la raison : se fasse vert, et en prime social, au service de tous. Mais ce système va-t-il vraiment « se soigner », comme l’annoncent certains ? devenir vertueux ? devenir responsable ? La puissance industrielle pourrait-elle vraiment se mettre au service de la planète ? C’est ici qu’Ellul peut nous servir de boussole. Un, il rappelle que l’organisation industrielle, la société technicienne, je cite, « ne sont pas des systèmes destinés à produire des biens de consommation ni du bien-être, ni une amélioration de la vie des gens, mais uniquement à produire du profit. Exclusivement. Tout le reste est prétexte, moyen et justification ». Deux : « Il est totalement illusoire de prétendre que l’on peut mettre la puissance au service des valeurs et qu’en augmentant la puissance, les valeurs seront mieux défendues. Cela est tout à fait irréaliste et irréel. En réalité, la croissance de puissance efface les valeurs, sauf celles qui servent cette puissance » (14).
Ici, juste une incise. Dans cette société technicienne qui est la nôtre, certains des personnages aux postes les plus élevés dans la technostructure n’affichent pas leur espoir dans un capitalisme vert et responsable, comme le font désormais la majorité d’entre eux, mais dans une accélération de l’artificialisation du monde. Vous connaissez la fameuse formule, « une croissance infinie est impossible dans un monde fini », qui nous vient du rapport Meadows (club de Rome 1972). Elle constitue la condamnation la plus percutante de notre système, et semble imparable. Mais certains sont persuadés d’avoir trouvé la parade. Ils sont sûrs qu’une croissance infinie est possible dans un monde fini. Et ce grâce à l’intelligence artificielle, aux nanotechnologies, aux révolutions dans la biologie (comme les ciseaux moléculaires Crispr, qui permettent de trifouiller le vivant, de coller ensemble deux brins d’ADN, et grâce auxquels un chercheur chinois dit avoir modifié le gène de deux fillettes de sorte qu’il leur confère une résistance au virus HIV). Ils croient que ce bouleversement technique va permettre à l’Homme, ou du moins à la Technostructure, de modifier le monde en profondeur, de s’en rendre totalement maître, de créer artificiellement de nouvelles espèces végétales et animales (qui seront évidemment bien plus réussies que celles qui existent aujourd’hui, et dont les plantes et les animaux transgéniques ne constituent qu’un avant-goût), et de créer un homme nouveau qui fusionnera avec la machine, et qui ne mourra plus jamais. Vous avez reconnu le transhumanisme prôné par Ray Kuzweil, ce chercheur largement subventionné par Google, et défendu par les pontes de la Silicon Valley, Elon Musk, Marck Zukerberg, Jeff Bezos, Bill Gates. Et si tout ça ne marche pas, on ira sur Mars ! Il n’est pas saugrenu de penser que nous sommes actuellement dans une course de vitesse avec eux, les transhumanistes, qui prétendent remodeler le monde du vivant de A à Z, et annoncent aux récalcitrants qu’ils seront les « chimpanzés du futur » (15). Une course de vitesse entre le transhumanisme et la décroissance, qui veut préserver le vivant tel qu’il est.
9.
En France, que se passe-t-il ? Que font nos gouvernants ? L’une des grandes nouveautés en matière de biodiversité, c’est l’irruption d’un nouveau concept, la « compensation ». Elle vient tout droit du Grenelle de l’environnement de 2007 qu’avait initié Sarkozy. L’idée est qu’on peut continuer à bétonner les sites naturels, et même ceux où vivent des espèces animales protégées, à y construire des autoroutes et des hypermarchés, des lotissements ou des zones industrielles. Mais en « compensation », les bétonneurs doivent s’occuper d’un autre site, et y faire renaitre une vraie biodiversité. Vous détruisez trois hectares où vit le lézard ocellé ? Vous n’avez qu’à acheter ailleurs un autre espace à peu près aussi grand, et le restaurer pour le rendre habitable, peut-être pas par le lézard ocellé, qui ne se sent pas bien partout, mais par la pipistrelle. Et voilà, vous avez com-pen-sé. L’idée, c’est d’obtenir « zéro perte nette, voire un gain de biodiversité ». En théorie, ça pourrait se tenir, c’est un moindre mal, cela permet de continuer à aménager le territoire, mais sans trop de casse. En pratique, comme viennent de le montrer des biologistes du Museum d’histoire naturelle qui ont étudié de près les 25 plus gros projets d’aménagement français de ces dernières années et leurs compensations, c’est de l’enfumage, rien d’autre. 80% des destructions ne sont pas compensées tout en prétendant l’être. Tout en détruisant d’un côté, de l’autre les aménageurs achètent des terrains plus ou moins naturels qu’ils font entretenir quelques années, et basta. Voilà comment on peut continuer à bétonner chaque années 60 000 hectares en toute bonne conscience.
La même logique est à l’œuvre à l’échelle mondiale. Elle est très bien décrite dans un livre qui a pour titre « Prédation » (16). On voit apparaitre des « bio-banques », qui par exemple achètent à Bornéo des hectares de forêt où vivent des orangs-outans. Ces hectares sont sanctuarisés, et donc les orangs-outans protégés. Ayant investi de l’argent pour sanctuariser ces réserves, les entreprises qui déforestent pour l’huile de palme peuvent désormais se proclamer vertueuses, et continuer tranquillement leur business. Il existe même un site, speciesbanking, où on peut voir quelle banque essaie de protéger –à sa manière- la salamandre tigre ou le renard du désert… Une ONG basée à Bruxelles, Green Finance Observatory, a publié en mai dernier un rapport d’où il ressort (17), comme le dit son porte-parole Frédéric Hache, que « mettre un prix sur la nature est une formule accrocheuse, mais réglementer la destruction de la nature est une alternative bien plus efficace ». Grâce à la compensation, on fait admirablement semblant de réglementer cette destruction.
10.
Petite histoire en deux temps. Voilà quelques années, je suis allé voir une pièce de Jean-Michel Ribes (18) au théâtre du Rond Point, à Paris. Macron est venu s’asseoir juste devant moi, avec son épouse et une partie de son cabinet. Il était alors ministre de l’économie de Hollande. A la fin de la pièce (pas très bonne, d’ailleurs), je l’ai vu applaudir. Mais il applaudissait sans que ses mains ne se touchent. De manière très démonstrative, mais complètement silencieuse. Et « en même temps », il criait : « Bravo ! » C’était très étonnant. Je me demande pourquoi je me suis alors rappelé qu’il avait fait ses études chez les Jésuites.
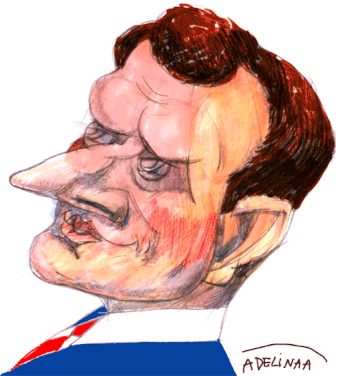
11.
Une autre scène. Début mai, cette année. La 7° session plénière de l’IPBES vient de se tenir à Paris. Les experts venus du monde entier lancent leur cri d’alarme sur l’extinction en cours. Le président Macron s’avance solennellement sur le perron de l’Elysée. « Ce qui est en jeu est la possibilité même d’avoir une Terre habitable », dit-il. Et il fait cette promesse : « d’ici 2022, nous porterons à 30% la part de nos aires marines et terrestres protégées en pleine naturalité ». Que se passe-t-il alors sur notre écran mental ? D’abord, on pense brièvement qu’il jargonne : « en pleine naturalité ». Officiellement, ce terme signifie qu’il s’agit du plus haut degré de protection. Mais il est des plus vague, et ne correspond à aucune des cinq catégories définies par l’UICN et communément admises dans le monde entier. 30% ! On pense que, bon, sans doute exagère-t-il un peu, mais notre président n’étant ni Poutine ni Trump, il ne peut mentir complètement. On se met donc à penser que si, d’ici trois ans, il arrive à protéger près du tiers de notre territoire, c’est pas mal, non ? Ce sera un niveau de protection appréciable…

Erreur sur toute la ligne. Macron a juste effectué un joli tour de passe-passe. Son chiffre est à la fois vrai, et en même temps complètement bidon. En réalité, si l’on considère la métropole et qu’on additionne les réserves biologiques intégrales, les réserves naturelles régionales, et les parcs nationaux, on arrive à environ 1% du territoire qui est protégé. 1% ! Si l’on ajoute les parcs naturels régionaux, ce chiffre grimpe officiellement jusqu’à 29,5%. Mais ces 53 parcs, qui couvrent plus de 8 millions d’hectares, n’offrent aucune vraie protection réglementaire. On peut y construire, y couper du bois et y chasser comme partout ailleurs, seule une « charte de bonne conduite » est censée y protéger le vivant. Pour arriver à 30%, il est prévu d’étendre ici et là quelque 27 réserves…
Même chose pour les aires marines. Seules 1% d’entre elles sont réellement protégées. Mais le chiffre officiel est de 22. C’est en créant, d’un trait de plume magique, deux nouvelles aires, l’une dans la zone économique exclusive (ZEE) de Saint Paul et Amsterdam (îles des terres australes), et l’autre aux îles Glorieuses (près de Madagascar), que Macron réussit à ajouter 550 000 km2 d’aires prétendument protégées.
A ce propos : Edward Osborne Wilson, le biologiste qui le premier a alerté sur l’extinction, a sorti en 2016 un livre (non traduit en français), qui s’intitule Half-earth : la moitié de la terre (19) Après avoir rappelé qu’il existe dans le monde 161 000 réserves naturelles sur terre, et 65 000 en mer, soit 15% de la surface terrestre et 2,8% de la surface océanique, il dit qu’il faut aller beaucoup plus loin. Il fait cette proposition : sachant que selon une constatation faite au XIX° siècle, si 90% d’une aire est supprimée, le nombre d’espèces ne chute que de 50%, il affirme que si on protège la moitié des habitats de la planète, alors 85% des espèces survivront. Son mot d’ordre, donc : protégeons la moitié des habitats de la planète. Un chiffre simple, propre à marquer les esprits. Ce serait intéressant de se poser la question : protéger la moitié de la France concrètement, ça voudrait dire quoi ? Mais il faudrait aussi se poser celle-ci : faut-il forcément étendre les surfaces protégées ? Ne vaut-il pas mieux renforcer la protection dans les zones existantes ? Et limiter drastiquement les dégâts dans le reste du territoire ? Ne pas découper le pays en zones à exploiter à mort, et zones à préserver pour se donner bonne conscience ? Dans un beau livre optimiste (20), le naturaliste Gilbert Cochet et le biologiste Stéphane Durand ouvrent des pistes, montrent que nombre d’espèces sont capables de vivre à proximité de nous, et qu’il serait encore possible de « ré-ensauvager la France ».
12.
Et maintenant, « les gens ».
Parlons d’abord de ceux qu’on entend dans les médias.
Ceux qui parlent le plus fort et sont le plus entendus ne sont pas forcément les spécialistes, ni d’ailleurs ceux qui sonnent l’alerte depuis longtemps, militants écolos ou activistes. Face à cette crise globale, climatique et biologique, on voit apparaitre des lanceurs d’alerte d’un type nouveau. Deux livres sont sortis cette année, aux titres grandiloquents : « L’humanité en péril » (21) de l’auteure de polars Fred Vargas, et « le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » (22), de l’astrophysicien Aurélien Barrau. Ce sont des best-sellers. Ils sont symptomatiques. Ils ne font pas que reprendre l’état des lieux rabâché partout. Ils essaient aussi de donner des solutions. Ils dressent des listes. Fred Vargas fait la liste de ce que « nous, les gens » pouvons et devons faire : réduire notre consommation de viande de 90%, tenter de nous limiter à 30 pièces d’habillement par personne, prendre le train plutôt que l’avion, etc. Elle dresse aussi la liste de ce que doivent faire ceux qu’elle appelle « les gouvernants du monde » : soutenir les entreprises qui investissent dans la dépollution, financer l’élevage et l’agriculture biologique, interdire les pesticides qui massacrent les insectes pollinisateurs, classer au patrimoine de l’Unesco les forêts primaires d’Amazonie, d’Indonésie, du bassin du Congo, etc. C’est sympathique, un peu naïf, complètement a-politique. Fred Vargas a l’ardeur des nouveaux convertis. Cette conviction que puisqu’elle-même vient de prendre conscience de la catastrophe en cours, tout le monde doit s’y mettre à son tour, et que les gouvernants étant gens de bonne volonté, ils vont eux aussi comprendre la situation, et utiliser le pouvoir qui est entre leurs mains pour sauver la situation.
C’était un peu l’attitude de Nicolas Hulot : croire qu’il suffit de donner des conseils au prince pour que celui-ci les écoute.
L’autre livre, celui d’Aurélien Barrau, est plus troublant. Lui aussi fait des listes de tout ce qu’il faut faire. On y trouve des choses bizarres. Par exemple, faire diminuer la consommation « de gré ou de force ». De gré ou de force, tiens donc ! On aurait aimé qu’il précise sa pensée. Il dit aussi qu’il faudrait un « réel partage des richesses », de manière à ce que les pauvres ne soient pas obligés d’acheter en grande surface des trucs produits dans des conditions humaines et environnementales déplorables. Certes, voilà une belle idée, on est tous d’accord. Mais comment faire ? Aurélien Barrau dit que ça ne « nécessite pas un chamboulement drastique de notre système économico-politique ». D’un autre côté, il dit, dans un discours qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, qu’il va falloir « des mesures politiques concrètes, coercitives, impopulaires, s’opposant à nos libertés individuelles, on ne peut plus faire autrement ». Et il semble faire confiance à Macron, commentant ainsi le fait qu’il ait été décoré par l’ONU du titre de « champion de la Terre » : « Parfois, endosser le costume de superhéros peut vous donner envie de vous comporter comme tel. C’est ce que j’espère. » Avons-nous besoin de super-héros ? D’hommes à poigne ? Faut-il rêver d’un régime autoritaire ? Ces deux livres sont un peu courts.
Mais ils révèlent l’état d’esprit dominant. Toutes les élites politiques, économiques, médiatiques, scientifiques, vont dans ce sens-là. Face à la catastrophe, on va corriger le système, le rendre plus vertueux, et ça ira mieux. On peut entendre des déclarations comme : « L’écologie est une clef pour la compétitivité en Europe », ou « les technologies vertes peuvent avoir le même rendement que les industries polluantes ». On annonce qu’il va y avoir « une floraison d’inventions, des méthodes et des processus plus performants et plus écologiques », et que c’est en intensifiant le recours aux nouvelles technologies que l’Europe va rester compétitive, et devenir un modèle écologique qui inspirera le monde entier.

Tous nos dirigeants partagent cette croyance.
Comme l’a montré Ellul, elle relève d’un article de foi bien connu : c’est grâce à la technique que seront résolus les problèmes créés par la technique. Grâce à elle qu’on va avoir le beurre et l’argent du beurre. C’est de la pensée magique. On va poursuivre une croissance infinie dans un monde fini, mais attention comme ça sera de la croissance verte, ça va marcher. Quiconque pense autrement est un arriéré, un partisan du retour au Moyen Age, à la bougie, un utopiste, un dangereux zadiste, bref, en un mot : un partisan de la décroissance. Et ça, la décroissance, c’est l’horreur !
13.
Mais on entend aussi, à côté de ce discours dominant et gentiment réformiste, un autre son de cloche. Bref retour en arrière. Toute une génération, celle des gens qui sont nés au début du XX° siècle, celle d’Arthur Koestler, de Stefan Zweig, de George Orwell, a été façonnée par le sentiment que leur monde s’enfonçait dans le chaos (23). Ils avaient connu l’effondrement de la première guerre mondiale, qui fut la plus grande boucherie de l’histoire de l’humanité, puis la montée des fascismes, puis la seconde guerre, la première explosion atomique, la guerre froide… Nous sommes (peut-être) en train d’assister chez les jeunes à la naissance d’un sentiment du même ordre, et ce sentiment pourrait entièrement façonner les générations à venir. Les marches pour le climat, la pétition de l’Affaire du siècle, les interventions de Greta Thunberg, la démission de Nicolas Hulot (qui a été un vrai déclencheur, la révélation du double discours du politique, ce moment de basculement où, comme dans le conte d’Andersen, chacun comprend que le roi est nu)…

Ces événements récents semblent marquer un changement, un vrai changement. Ces générations sont en train de se rendre compte que le monde dans lequel elles arrivent s’enfonce dans le chaos. Et que ce monde a beau le savoir et ne cesser d’en parler, il ne fait rien.
Ces générations ont quelque chose que nous n’avons pas. J’avais 18 ans quand j’ai lu le rapport du Club de Rome. C’était le début des années 70, nous étions loin d’être désespérés : la candidature de René Dumont, la naissance des Amis de la Terre, le journal « la Gueule Ouverte », les premières manifs contre le nucléaire, le Larzac, les utopies, les communautés, la contre-culture... Nous pensions remporter des batailles. L’ennemi ne nous paraissait pas si fort. L’avenir ne ressemblait pas à un ciel sans nuage. On savait bien, certes, que Woodstock était une bulle, une oasis. Mais l’avenir ne ressemblait pas, comme aujourd’hui, à une menace. Il y avait contre nous les habitudes mentales, métro-boulot-dodo, la « société de consommation » qu’on voyait se développer ; les dirigeants obtus, Pompidou, Marcellin, Giscard, Poniatowski, Raymond Barre ; les technocrates, les nucléocrates… Ceux qui militaient le faisaient contre un régime politique, contre le capitalisme, l’armée, le nucléaire. Mais nous n’avions pas le sentiment d’avoir en face de nous un monde mondialisé. On parlait des multinationales comme d’une menace à venir, pas comme d’une réalité. Les GAFA plus puissantes que les Etats, ça n’existait pas. Certes, on entendait les cris d’alarme de Jean Dorst, Rachel Carson, André Gorz, René Dumont, Pierre Fournier, Ivan Illich… Mais on n’avait pas le sentiment d’avoir affaire à une Mégamachine. Seuls quelques analystes comme Ellul ou Charbonneau avaient déjà cette vision d’un système technicien total, englobant Etats et entreprises, et régimes politiques, mais ils n’étaient guère entendus.
Aujourd’hui, avec le dérèglement climatique et la 6° extinction, cette vision s’impose à tous –même si elle n’est pas exprimée exactement en ces termes. J’ai entendu une jeune femme me dire qu’elle ressent tragiquement cette réalité. Et que ce sentiment du tragique, elle a besoin de le partager, de le vivre de manière collective. Ce sentiment-là, ma génération ne l’a jamais éprouvé.
14.
C’est peut-être lui qui est à l’origine de nouveaux modes d’action. Tout le monde a compris que les gestes individuels ne suffisent plus. Tout le monde a compris aussi que les cris d’alerte, les discours, les marches, le vote écolo, ça ne suffit pas. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, ne supportent plus de vivre avec ce sentiment d’impuissance. Avec ce constat que les gouvernants se sont enfermés dans leur logique croissanciste. Ils veulent œuvrer concrètement, contraindre les gouvernants à passer à l’action, agir sur les infra-structures qui sous-tendent et organisent nos sociétés. Jean-François Julliard, l’actuel patron de Greenpeace, raconte comment il voit débarquer de nouveaux arrivants qui veulent des actions plus radicales, qui veulent bloquer, ralentir, mettre des grains de sable. On peut y voir le prolongement de la ZAD de Notre-Dame des Landes, la grande invention politique de ces dernières années. Voilà que tout à coup, des gens critiquent un projet non pas parce qu’ils en sont riverains (on connait le syndrome NIMBY, faites tout ce que vous voulez mais pas dans mon jardin), mais parce qu’ils se demandent quelle est vraiment son utilité, s’il est porteur d’un quelconque progrès, si ça vaut vraiment le coup de détruire des centaines d’hectares de campagne pour envoyer des touristes low-cost en vacances pendant une semaine en République dominicaine. Pour la première fois, on assistait à une vraie critique de la technique en actes. Parlons des actions les plus visibles, les plus récentes.
Deux nouveaux modes d’action ont vu le jour récemment : les actions en justice, et la désobéissance civile.
Les actions en justice se sont inspirées du collectif de citoyens hollandais Urgenda. En 2015, ils attaquent devant le tribunal de La Haye l’Etat néerlandais parce qu’il ne lutte pas assez vigoureusement contre le dérèglement climatique. Le tribunal leur donne raison, et enjoint le gouvernement à en faire plus. Il y a aussi la ville de New York, qui a attaqué les cinq principales compagnies pétrolières mondiales : elle les accuse de mettre la ville en danger en favorisant la montée des eaux. Il y a aussi ce tribunal qui, en Australie, en février de cette année, a interdit un projet de mine de charbon à ciel ouvert en invoquant notamment l’impact sur le climat. En France, plusieurs associations dont Greenpeace ont initié l’Affaire du siècle : là encore, il s’agit d’attaquer en justice l’Etat pour inaction climatique. Ce recours a fait grand bruit et été signé par plus de 2 millions de personnes. Signe qu’il gêne le pouvoir : d’un côté le ministre écolo d’alors, François de Rugy, a salué la mobilisation citoyenne, de l’autre il a répété ce qui semble un argument de bon sens : « ce n’est pas dans un tribunal qu’on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre ». A-t-il raison ? Ce type d’initiative va-t-il judiciariser les luttes ? En appeler aux juges, est-ce forcément dépolitiser la lutte ?

C’est la position du journal « La Décroissance », qui ne mâche jamais ses mots, et tant mieux. Je serais moins sévère qu’eux. Je crois que ces actions gênent le pouvoir, ce qui est toujours bon à prendre. Et qu’elles permettent d’interpeller l’opinion. Le patron de Greenpeace, Jean-François Julliard, se montre très partant pour toutes ces initiatives (24). Il dit que « le potentiel d’interpellation est immense ». Y aura-t-il bientôt, dix, cent, mille, cent mille actions en justice ? Rappelons que, déjà, nombre d’associations écolos s’épuisent à mener des actions en justice simplement pour faire respecter le droit de l’environnement. Depuis sa fondation, voilà près de 40 ans, l’ASPAS, association pour la protection des animaux sauvages, a engagé plus de 3500 procédures devant les tribunaux…
Dans le même registre juridique, mais d’une manière très différente, on voit aussi apparaitre tout un mouvement qui cherche à faire reconnaitre la nature et les écosystèmes comme des personnalités juridiques ayant des droits. Après tout, disent certains, même une société anonyme a une personnalité juridique, alors pourquoi pas un fleuve, une forêt, une espèce ? Déjà, dans certains pays comme la Nouvelle Zélande, on en a donné à des fleuves, pour des raisons certes culturelles, et spirituelles, ces fleuves étant considérés comme sacrés. Plusieurs auteurs, ainsi Bruno Latour, imaginent que dans les grandes négociations internationales on pourrait faire en sorte que des humains parlent au nom d’une espèce ou d’un écosystème. Pourquoi pas ? Un porte-parole des abeilles qui serait présent lors des négociations de la PAC, ça en ferait peut-être rire beaucoup, mais ça pourrait être efficace. Et ça donnerait la parole à ceux qui n’en ont pas.
La désobéissance civile, autre nouveau mode d’action. De plus en plus nombreux sont ceux qui mènent des actions dont ils savent qu’elles peuvent leur valoir condamnation judiciaire. Ceux qui décrochent les portraits de Macron dans les mairies, une action menée par une branche d’Alternatiba, ANV-Cop21. Les trente militants de Greenpeace qui ont pénétré dans deux centrales nucléaires pour montrer que la sécurité n’était pas assurée -certains ont pris de la prison ferme. Ceux qui perturbent les assemblées générales de Total pour l’empêcher de forer au large de l’Amazone. Des associations comme Greenpeace ou les Amis de la Terre forment chaque année des milliers de personnes à l’action non-violente.
En novembre dernier, on a vu l’émergence du mouvement anglais Extinction Rebellion. Son logo représente, en vert sur fond noir, un sablier au milieu de la Terre : ceci pour rappeler que le temps est compté pour de nombreuses espèces. Extinction Rebellion se veut un réseau non-violent de désobéissance civile. Il pose trois grandes revendications : l’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, la neutralité carbone d’ici 2025, et la création d’une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour mener à bien ces projets. Ses membres sont persuadés qu’en mobilisant 3,5% de la population, on peut déclencher un changement de système, comme l’affirme Erica Chenowzeth, la chercheuse en sciences politiques dont ils s’inspirent. Leur premier coup d’éclat a été de rassembler plusieurs milliers de participants pour bloquer cinq ponts à Londres. Un blocage dont le but affiché était de pousser le gouvernement britannique à prendre l’engagement d’aboutir à zéro émission nette de CO2 en 2025 (ce qu’il s’est bien gardé de faire !). Ils ont une branche française qui a, entre autres, le 26 août à Bordeaux, bloqué un navire de croisière qui remontait la Garonne pour s’installer au centre-ville. Uniquement symboliques, ces actions ? Peut-être, mais elles ont le mérite de faire réfléchir, de faire apparaitre les tensions sur les vrais enjeux. Ellul le disait : nous vivons dans une société qui n’est pas assez conflictuelle. Les médias, la télé surtout, débordent de faux débats, où s’expriment des experts autoproclamés et des vedettes médiatiques, mais les vrais conflits restent inexprimés, étouffés. A force, ça donne les gilets jaunes... Si les actions symboliques des différents groupes comme Extinction Rebellion et les autres ne réussissent pas à bousculer l’ordre établi, à faire apparaitre les vrais conflits et les vrais enjeux, cela pourrait poser rapidement de vrais problèmes. Déjà, on trouve sur le Net une branche française du réseau américain Deep Green Resistance, qui essaie de recruter avec ce mot d’ordre : « La civilisation industrielle détruit la planète. Organisons-nous et résistons ! ». Là, on passe à une autre échelle : il s’agit de mener des actions violentes, de mettre en place des réseaux clandestins de militants, de passer au sabotage pour, je cite, « provoquer l’effondrement industriel général ». Les gouvernements n’attendent que ça : des écolos qui commettent des actions violentes afin de pouvoir enfin les assimiler aux terroristes. Déjà, aux Etats-Unis, le FBI a désigné les écolos radicaux comme la principale menace terroriste après l’islamisme.
Un signe que c’est toute une génération qui cherche à reprendre en main son avenir : même les futures élites sont saisies par le doute ! En avril 2018, les élèves de Sciences-Po demandent à leur école, qui déjà n’accepte plus les partenariats avec l’industrie des armes et du tabac, de mettre fin à leur partenariat avec Total. Leur association s’appelle Sciences Po zéro fossile. En novembre dernier, un groupe de jeunes étudiants à Polytechnique, HEC, et l’Ecole des Mines lance un « Manifeste pour un réveil écologique », qui recueille 30 000 signatures. Ils interpellent ainsi leurs futurs employeurs, les grands groupes, en leur disant qu’ils ne veulent pas travailler pour eux s’ils ne changent pas leurs pratiques : « Au fur et à mesure que nous nous approchons de notre premier emploi, nous nous apercevons que le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles avec le fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradictions quotidiennes »
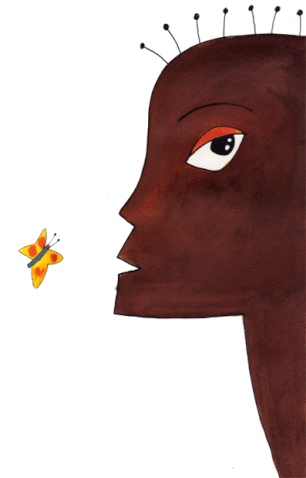
15.
Ces récentes mobilisations montrent que quelque chose a changé : notre rapport au temps. La grande question est désormais : avons-nous le temps ? Le sentiment d’urgence domine. Les experts du GIEC disent qu’il nous reste une dizaine d’années pour limiter les conséquences du dérèglement climatique. Mais tout le monde sait que contenir le réchauffement à 1,5°, ce qui est l’objectif de la COP21, nécessiterait des transitions sans précédent historique. C’est donc impossible. Fin 2017, 15 000 scientifiques de 184 pays ont publié un texte intitulé « Demain il sera trop tard ». Nombreux sont ceux qui pensent qu’il est déjà trop tard. Que l’effondrement va survenir, quoi qu’on fasse, et que nous le verrons de notre vivant, et même, que nous sommes en train de le vivre : vous avez reconnu les collapsologues, dont Pablo Servigne est le principal porte- parole. Son livre, « Comment tout peut s’effondrer » (25), paru en 2015, présente de manière structurée, puissante, ramassée, tout ce que nous sommes nombreux à répéter depuis des années sur les effets de seuil, les points de rupture, etc. Je n’imaginais pas qu’il frapperait les esprits à ce point, et deviendrait un best-seller (il s’en est vendu plus de 60 000 exemplaires et il s’en vend encore 700 par semaine). Les collapsologues annoncent l’effondrement comme inéluctable, scientifiquement inéluctable. Ils nous assignent deux urgences : il va nous falloir survivre, et nous adapter.
Cette vision des choses est très controversée . On leur reproche d’annoncer cet effondrement sans pour autant remettre en question le règne de la marchandise et les rapports d’exploitation et de domination qui vont avec, sans s’interroger sur les structures de pouvoir de nos sociétés. En ne désignant pas comme premier responsable le capitalisme industriel, en prônant la résilience, et pas la résistance, en proposant la permaculture comme panacée universelle, en oubliant de réfléchir aux structures de pouvoir à mettre en place après l’effondrement, ils ne feraient que démobiliser les foules. Et, finalement, nous mener à une sorte d’acceptation du monde actuel. Ce débat le montre : la collapsologie permet à chacun de reconsidérer ses positions, de les préciser, parfois d’en changer. Se préparer à l’effondrement, est-ce vraiment renoncer à se battre ici et maintenant ? N’oublions pas que ce système n’est pas seulement capitaliste : question exploitation, domination et flicage, la Chine communiste fait plus fort que nous. Jacques Ellul n’a cessé d’y insister : c’est un « système technicien » qui domine aujourd’hui la planète.
16.
La collapsologie est une des variantes d’un « grand récit » qui est en train de se constituer. Plusieurs ouvrages sont sortis récemment, qui tournent autour de la même idée : il va falloir apprendre à vivre dans les gravats. A vivre dans un monde abîmé, comme le dit la revue Critique (26). A vivre dans les ruines du capitalisme, comme le dit Anna Tsing (27) dans un livre titré « Le champignon de la fin du monde ». Elle raconte comment le matsutake, un champignon qui ne vit que dans les forêts malades, à moitié détruites, est cueilli dans l’Oregon par des communautés de travailleurs précaires, des vétérans américains, des immigrés sans papiers. Et comment ce champignon est vendu à prix d’or au Japon dans les épiceries fines. De là, elle tire une leçon d’optimisme : vivre dans les ruines, ce n’est pas forcément que survivre. C’est aussi vivre avec de nouveaux alliés, humains et non humains.


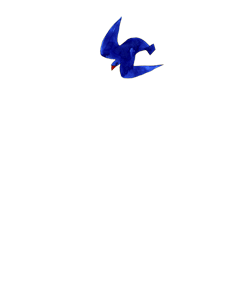
17.
Les derniers siècles du grand pingouin ne furent qu’une fuite éperdue. En l’an 1534, quand Jacques Cartier arrive en vue de Terre Neuve, il fait halte sur l’île aux oiseaux. C’est là que tous les pêcheurs de morues viennent s’approvisionner pour la saison de pêche. L’île déborde de grands pingouins. Elle en est si pleine, dit Cartier, « qu’il semble qu’on les ait entassés ». Il y en a tellement que les marins les plument vivants. Comme il n’y a pas un arbre sur cette île, ils s’en servent comme combustibles : « Vous prenez une marmite, dans laquelle vous jetez un ou deux pingouins, vous allumez un feu en dessous, et ce feu est uniquement alimenté par les malheureux pingouins eux-mêmes. Leurs corps huileux produisent bientôt une flamme ». C’est l’abondance. Cartier dit : « Cette île est si plein d’oiseaux que tous les navires de France s’en pourraient charger sans que l’on s’aperçoive que l’on en a retiré ». Mais trois siècles plus tard, il n’en reste plus un seul. Quand en 1833, Audubon peint son grand pingouin, dans l’Amérique censée être encore vierge, et sauvage, pas abîmée par l’homme, c’est à partir d’un spécimen empaillé.
Evidemment, il y avait eu des cris d’alarme quelques dizaines d’années auparavant. En 1775 le gouverneur de Terre-Neuve écrit à son ministre de tutelle anglais pour lui demander d’interdire qu’on ne chasse le grand pingouin que pour ses plumes (car, en plus de sa chair, ses plumes aussi étaient convoitées !). L’interdiction ne vient que vingt ans plus tard. Mais de toute façon c’est déjà trop tard. Le grand pingouin se réfugie dans les régions arctiques inaccessibles aux hommes. Il va de plus en plus loin. Les collectionneurs mettent sa tête à prix. Ses œufs s’arrachent à prix d’or. Son avant-dernier refuge, ce sont les quatre îles volcaniques de Geirfuglaster, au large de l’Islande, entourées de courants violents. Mais en 1830, cette région connait de fortes secousses sismiques. Les îles sont englouties. Les derniers pingouins se réfugient sur l’île d’Eldey. Et le 3 juin 1844, les deux derniers disparaissent. Le Grand Pingouin avait vécu 3 millions d’années. Il a suffi de trois siècles pour le faire disparaitre.
18.
« Nous sommes tous des grands pingouins », c’est le titre de cette conférence. Est-ce que ça veut dire que nous allons disparaitre, comme les grands pingouins ? Que l’anthropocène
va être l’ère de la disparition de l’homme ? Sans doute pas. Je ne crois pas, comme Yves Cochet (28), à la disparition de la moitié de l’humanité d’ici 2050. Mais il est possible que pour
nous aussi, la fuite soit éperdue. Et fuir, c’est d’abord et avant tout, ne pas être libre de ses mouvements, de son destin, libre de vivre en accord (ou non) avec ce monde. Ce qui risque de
disparaitre, c’est, tout simplement, notre liberté.
Jean-Luc Porquet

(1) Raphaël Billé, Philippe Cury, Michel Loreau, Virginie Maris, Biodiversité : vers une sixième extinction de masse (La ville brûle, 2014)
(2) Le Canard enchainé (7/1/2015)
(3) Bruno Durieux, Contre l’écologisme, pour une croissance au service de l’environnement (éditions de Fallois, 2019)
(4) Sylvie Brunel, Toutes ces idées qui nous gâchent la vie, alimentation, climat, santé, progrès, écologie… (JCLattès, 2019)
(5) Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique, Grasset, 1992
(6) Alain Pavé, Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses (Seuil, 2019)
(7) Richard Leakey, La sixième extinction (Flammarion, 1995)
(8) Elizabeth Kolbert, La sixième extinction (Vuibert, 2014)
(9) Edward Osborne Wilson, Sauvons la biodiversité (Dunod, 2007)
(10) Stéphane Foucart, Et le monde devint silencieux, Comment l’agrochimie a détruit les insectes (Seuil, 2019)
(11) Jean-Luc Porquet, Lettre au dernier grand pingouin (Verticales, 2016)
(12) Valéry Laramée de Tanenberg, Agir pour le climat, Entre éthique et profit (Buchet-Chastel, 2019)
(13) William Nordhaus, La casino climatique, Risques, incertitudes et solutions économiques face à un monde en réchauffement (De Boeck Supérieur, 2019)
(14) Cité dans Jean-Luc Porquet, "Jacques Ellul, l'homme qui avait (presque) tout prévu" (Cherche Midi 2003,2012), p. 309
(15) PMO, Manifeste des chimpanzés du futur (Service compris, 2017)
(16) Christophe Bonneuil et Sandrine Feydel, Prédation, Nature, le nouvel Eldorado de la finance (La découverte, 2015)
(17) Green finance observatory, 50 shades of green, the fallacy of environmental markets, mai 2019
(18) Par-delà les marronniers, de Jean-Michel Ribes, Théâtre du Rond Point, mars 2016
(19) L’Ecologiste n°54 (avril-juin 2019)
(20) Ré-ensauvageons la France, Gilbert Cochet, Stéphane Durand, Actes Sud, 2019
(21) Fred Vargas, L’humanité en péril, Virons de bord, toute ! (Flammarion, 2019)
(22) Aurélien Barrau, Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité, Face à la catastrophe écologique et sociale (Michel Lafon, 2019)
(23) John Gray, Le silence des animaux, Du progrès et des autres mythes modernes (Les Belles lettres, 2018)
(24) Jean-François Julliard, On ne joue plus ! Manuel d’action climatique et de désobéissance civile (Don Quichotte/Seuil, 2019)
(25) Pablo Servigne, Comment le monde peut s’effondrer (Seuil, 2015)
(26) Critique n°860-861, Vivre dans un monde abîmé (janvier-février 2019)
(27) Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde (Les empêcheurs de penser en rond/La découverte, 2017)
(28) Yves Cochet, Devant l’effondrement, essai de collapsologie (LLL, 2019)

Copyright © SCORBUT
